Nos Partenaires
Nos Dernières Actualités
Augmentation des forfaits hospitaliers : une attaque contre les plus modestes24 février 2026La publication récente de l’étude de la DREES (Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques) aurait dû provoquer un électrochoc. Elle démontre sans détour que notre système de santé pénalise déjà lourdement les ménages modestes. À revenu comparable, leur reste à charge est nettement plus élevé que celui des ménages aisés et ce malgré l’existence de la C2S. Mais il y a plus grave.
Pour la hausse des franchises médicales et les différents déremboursements, l’étude souligne que le coût rapporté au revenu est deux fois plus élevé pour les ménages modestes. Le constat est sans appel.
Dans ce contexte, l’augmentation des forfaits hospitaliers est une décision profondément injuste et socialement irresponsable. Elle frappe les assurés sociaux les plus fragiles : celles et ceux qui ne disposent pas d’une complémentaire santé ou qui n’ont pas les moyens financiers d’en souscrire une. Aujourd’hui, 2,5 millions de personnes, soit 4 % de la population, en sont dépourvues, un chiffre qui grimpe à 12 % parmi les 10 % les plus pauvres. Pour ces publics, cette hausse n’est pas un simple ajustement tarifaire : c’est une barrière supplémentaire à l’accès aux soins.
Le gouvernement ne peut pas ignorer les conséquences de ses choix. Les données sont connues, les alertes se multiplient, les inégalités sont documentées. Pourtant, rien ne change. Pire, les décisions prises aggravent les fractures sociales et sanitaires existantes.
Affirmer que les complémentaires santé absorberont l’augmentation des forfaits hospitaliers relève du mensonge. Chacun sait que cette hausse sera mécaniquement répercutée sur les cotisations. Une fois de plus, ce sont les assurés qui paieront la facture — toujours les mêmes : les plus modestes.
Pour l’UNSA, cette situation est inacceptable. La santé ne peut pas devenir un luxe réservé à celles et ceux qui ont les moyens. En augmentant les forfaits hospitaliers, le gouvernement organise le renoncement aux soins et tourne le dos aux principes de solidarité qui fondent notre système de protection sociale.
Loin de renforcer l’équité, cette mesure affaiblit notre système de santé et éloigne davantage les populations vulnérables d’un accès effectif aux soins. L’UNSA exige l’abandon immédiat de cette augmentation et l’ouverture de négociations afin de garantir un accès aux soins égal pour toutes et tous.
Crédits photo : DC Studio, sur Freepik [...]
Lire la suite…
La fiscalité des successions24 février 2026Souvent vilipendée comme taxe sur la mort, la fiscalité sur les successions est plus élevée que dans la moyenne des pays de l’OCDE. Elle rapporte au budget de l’État des recettes qui s’élèvent à 0,7% du PIB. Pour autant est-elle confiscatoire ?C’est loin d’être le cas : en 2022, 53% des successions ont été exonérées de tout droit.La fiscalité directe sur les successions est fondée sur un barème progressif, mais avec une progressivité pour le moins … insolite !
Comment ça marche ?En succession directe, les héritiers bénéficient d’une franchise de 100 000 €.
Au-delà de cette somme, à la part taxable, s’applique le barème ci-contre.On relèvera que s’il affiche une progressivité réelle, ce barème a toutefois un écart extrêmement marqué avec un rapport de 34,5 entre la borne basse de la quatrième tranche et la borne haute de cette même tranche.On taxe avec le même taux de 20% une succession de 120 000 € et une succession de 650 000 € !On pourrait concevoir une progressivité plus … progressive !
Mais l’astuce ne se limite pas là. Donation exonérée de 100 000 € par héritier possible tous les 15 ans, démembrement des propriétés foncières, exonération des assurances vie jusqu’à un certain seuil et autres niches fiscales permettent d’échapper largement à la taxation des successions. A partir d’un certain niveau de patrimoine, de subtils fiscalistes sont là pour éviter au contribuable de payer !
Plus efficace encore les niches fiscales, dont la célèbre niche Dutreil, permettant une large exonération de la taxation des entreprises lors de la succession, laquelle favorise les très gros héritages et a causé un manque à gagner de 5,5 milliards d’euros pour les finances publiques en 2024, selon le rapport de la Cour des comptes !
Qui paie quoi ?Les 0,1% d’héritiers les plus favorisés seraient loin de payer les 45% de la tranche terminale comme on l’entend parfois. Selon le Conseil d’Analyse Économique, ils acquitteraient un impôt inférieur à 10% du patrimoine perçu ! 10% sur un avoir successoral de 13 millions, ça fait 1,3 million. Pas mal, mais il en reste ! Beaucoup !Les seules successions qui font l’objet d’un prélèvement confiscatoire sont les successions indirectes, d’oncle ou tante à neveu ou nièce ou sans lien familiaux ( dans les couples reconstitués par exemple, conjoint non pacsé vis-à-vis des enfants de son conjoint, qu’il a parfois élevés) avec des taux de 55 à 60%.Alors que faire ?Nous n’avons pas la prétention de nous ériger en fiscalistes. Cependant, poser sans tabou le sujet de la fiscalité des gros patrimoines est une question de justice sociale et un gisement de ressources dans une société qui manque cruellement de moyens pour préparer l’avenir.
Au lieu de nous seriner à longueur de temps que ce sont les retraites qui plombent l’avenir des jeunes, il y aurait dans une réforme équitable de la fiscalité des successions, les moyens de redonner aux jeunes générations la possibilité de se construire un avenir.Cela pourrait passer par plus de progressivité dans le barème de l’impôt sur les successions, la réduction des donations exonérées, la limitation de certaines niches fiscales et leur redéfinition pour plus d’efficacité.
Sans introduction d’une plus grande équité fiscale, la concentration de plus en plus forte du patrimoine dans des mains de moins en moins nombreuses altèrera la cohésion sociale, déjà fortement fracturée, et ruinera le consentement à l’impôt. [...]
Lire la suite…
Explicite-Experts: Société à mission : un choix structurant et engageant pour le cabinet21 février 2026Il y a quelques mois, notre cabinet a officiellement adopté le statut de société à mission.
Ce choix s’inscrit dans une réflexion de fond sur le sens de notre activité, notre rôle auprès des organisations que nous accompagnons et la manière dont nous souhaitons faire évoluer nos métiers.
Une “société à mission” est une entreprise qui s’engage à poursuivre, en plus de son but lucratif, des objectifs environnementaux et sociaux, en lien avec sa raison d’être.
En s’engageant en tant que société à mission, une entreprise formalise sa volonté de contribuer à l’intérêt général et de concilier performance économique et impact positif sur la société et l’environnement.
Vous souhaitez en savoir un peu plus ? Nous vous invitons à lire notre article sur le sujet
https://www.explicite-experts.fr/societe-a-mission-un… [...]
Lire la suite…
Gel des tarifs des complémentaires santé 202621 février 2026La loi de financement de la Sécurité sociale impose aux organismes complémentaires d’assurance maladie, mutuelles et assurances, une contribution de 2,05%. La tentation est forte pour certains organismes de répercuter cette contribution sur les cotisations des assurés par une majoration de ces cotisations.Cette majoration est illégale et contestable. Explications :
La loi de financement de la Sécurité sociale 2026 a prévu une contribution de 2,05 % applicable aux organismes Complémentaires de l’Assurance Maladie. Cette contribution est assise sur l’ensemble des sommes perçues au titre des cotisations d’assurance maladie complémentaire.
L’article 13 de la LFSS 2026 stipule que « Pour l’année 2026, le montant de ces cotisations ne peut être augmenté par rapport à celui applicable pour l’année 2025 ».Certains organismes ont pu par anticipation appliquer une majoration des cotisations à leurs adhérents. Cette majoration est illégale et contestable.
Les assurés auxquels seraient appliqués cette majoration ont plusieurs voies de recours pour la contester. Adresser un courrier à la mutuelle ou à l’assurance complémentaire pour contester l’augmentation. Plusieurs organisations de consommateurs ont mis en ligne des courriers types. Recourir à une procédure de règlement amiable, et notamment saisir un conciliateur de justice, auxiliaire de justice assermenté (service public gratuit) ou un médiateur. Changer d’organisme d’assurance complémentaire.
Attention !Si l’on conserve l’organisme qui a appliqué la majoration illégale, il faut continuer à continuer à acquitter sa cotisation jusqu’à l’aboutissement du recours, sous peine de perdre la couverture complémentaire. [...]
Lire la suite…
Ukraine, 4 ans déjà18 février 2026En Ukraine, la guerre a été déclenchée par la Russie il y a 4 ans maintenant. Dans un appel intersyndical, l’UNSA s’exprime avec la CGT, la CFDT, FO, la CFE-CGC, la FSU et Solidaires pour une paix juste et durable. Nous réaffirmons notre solidarité avec l’Ukraine qui résiste. Nous appelons ensemble à participer à la marche pour l’Ukraine qui aura lieu le samedi 21 février à Paris au départ de la place de la République à 14h en direction de la place de la Bastille, et dans plusieurs autres villes en France.
2026_02_16_ukraine_appel_intersyndical_defTélécharger [...]
Lire la suite…
Une belle victoire!18 février 2026La loi de finances 2026 adoptée le lundi 2 février préserve l’abattement de 10 % sur les pensions et retraites.C’est une belle victoire !
La bataille a commencé en mars 2025, par une attaque coordonnée de Gilbert Cette président du Conseil d’Orientation des Retraites et Patrick Martin, Président du MEDEF qui ont réclamé la suppression de l’abattement de 10 % en l’assimilant de manière scandaleuse à la déduction de 10 % des frais professionnels des salariés. La mesure a été reprise dans le projet de loi de finances de l’éphémère Premier ministre François Bayrou, puis dans celui de son successeur Sébastien Lecornu.À l’UNSA Retraités, nous avons combattu, tout d’abord en expliquant l’historique et la nature de l’abattement de 10 % et en lançant notre pétition.Forts de votre soutien de plus de treize mille signatures, nous avons adressé aux parlementaires en octobre, une étude économique montrant l’impact de la suppression de la mesure et aussi du gel des pensions qui était prévu dans le projet de budget de la Sécurité sociale.Nous avons obtenu que la Commission des finances de l’Assemblée nationale se prononce le 21 octobre, contre la suppression ou la transformation de l’abattement de 10 %. La situation de maintien de l’abattement de 10 % sur les pensions et retraites a ensuite été préservée pendant le long processus d’adoption du budget 2026 par le Parlement.
Cette victoire est celle de votre mobilisation et vous pouvez en être fiers. L’UNSA Retraités sera toujours à vos côtés pour défendre votre pouvoir d’achat.
Merci de votre mobilisation et de votre soutien !L’équipe UNSA Retraités [...]
Lire la suite…
Emploi et handicap : l’UNSA appelle à une approche rénovée13 février 2026Dans son rapport d’évaluation des politiques publiques menées en faveur de l’emploi des travailleurs en situation de handicap, la Cour des comptes dresse un constat mitigé. Malgré un cadre législatif et des financements à hauteur de 2,9 Md€, l’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap reste largement en retrait des objectifs fixés. L’UNSA plaide pour une amélioration durable du pilotage des politiques publiques à destination des travailleurs handicapés et pour une vision rénovée des approches que l’État peut en faire.
Chaque année, près de 3 milliards d’euros sont mobilisés en milieu ordinaire et en secteur protégé pour l’insertion professionnelle des travailleurs en situation de handicap. Pourtant, leur taux d’emploi n’atteint que 39,3 % en 2023, contre près de 68 % pour l’ensemble de la population. Le taux de chômage demeure élevé, autour de 12 % contre 7% pour le reste de la population.
L’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH), fixée à 6 % dans les entreprises de 20 salariés et plus, reste insuffisamment respectée. En 2024, seules 35 % des entreprises assujetties atteignaient ce seuil par l’emploi direct, tandis que près de 28 % n’employaient aucune personne en situation de handicap, préférant s’acquitter d’une contribution financière.
La Cour des comptes pointe une obligation d’emploi affaiblie par des règles complexes, des dérogations multiples, des procédures de reconnaissance du handicap encore trop lourdes et une gouvernance éclatée, qui nuisent à l’efficacité globale de la politique publique.
Pour l’UNSA, ces constats appellent un changement de cap. L’inclusion professionnelle ne peut se limiter à une obligation formelle ou à des objectifs statistiques. Elle doit garantir des parcours professionnels sécurisés, un accès réel à la formation, des conditions de travail adaptées et le maintien durable dans l’emploi.
En ce sens, l’UNSA partage la nécessité de :• Sortir des enjeux quantitatifs pour valoriser une approche plus qualitative (qualité de l’intégration, promotions, déroulement des carrières, etc.),• Définir les missions et les moyens d’action des référents handicap et d’élargir leur désignation aux entreprises de plus de 50 salariés,• Faire évoluer la stratégie ministérielle et la feuille de route de la conférence nationale du handicap afin de les articuler avec les politiques de santé au travail, de lutte contre les discriminations et de formation en prenant en compte la qualité de l’emploi et doter cette stratégie d’objectifs mesurables,• Déployer une offre unifiée d’information et de conseil pour accompagner les employeurs notamment les petites structures.
L’UNSA appelle à une politique d’inclusion plus ambitieuse, plus cohérente et plus exigeante, fondée sur la dignité, la reconnaissance des compétences. Les moyens existent : ils doivent désormais produire des résultats à la hauteur des enjeux humains et sociaux. [...]
Lire la suite…
Prévenir, protéger, soigner : l’UNSA appelle une réponse nationale à la hauteur de l’enjeu du cancer5 février 2026Ce 4 février, la Journée mondiale contre le cancer a rappelé l’ampleur de cet enjeu de santé publique. Près de 430 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année en France, avec des inégalités sociales marquées. Pour l’UNSA, cette journée est l’occasion de réaffirmer une volonté claire. La lutte contre le cancer doit s’appuyer sur une prévention ambitieuse, des conditions de travail protectrices, un environnement sain et un accès aux soins garanti à toutes et tous.
Renforcer la prévention
La prévention reste l’outil le plus efficace pour réduire l’incidence des cancers, mais la France accuse un retard important. L’UNSA appelle à un investissement accru dans la prévention primaire, avec des campagnes accessibles, ainsi qu’à une meilleure participation aux dépistages organisés grâce à un accompagnement de proximité. À cela s’ajoute l’interdiction des dépassements d’honoraires pour l’ensemble des dépistages afin de garantir un accès universel à ces actes essentiels.
Protéger la santé au travail
De nombreux cancers sont liés à des expositions professionnelles. L’UNSA demande d’étendre les obligations des employeurs en matière de prévention, avec un contrôle effectif, et de faciliter la reconnaissance des cancers d’origine professionnelle. Cette démarche doit s’accompagner d’un renforcement de la médecine du travail, indispensable pour assurer un suivi régulier et de qualité de la santé des travailleurs.
Agir contre les pollutions
Les études le montrent, les pollutions atmosphériques, industrielles et environnementales aggravent les risques de cancer. L’UNSA propose de taxer les produits polluants et d’affecter ces nouvelles recettes fiscales à la Sécurité sociale afin de financer des campagnes de sensibilisation, des études épidémiologiques indépendantes et davantage de programmes de dépistage.
Garantir l’accès aux soins
Les inégalités sociales et territoriales d’accès aux soins aggravent la maladie et ses conséquences. L’UNSA demande des moyens accrus pour les centres de lutte contre le cancer et une action déterminée contre les déserts médicaux. L’accompagnement global des personnes touchées doit devenir la norme : soutien psychologique, programmes d’activité physique adaptée, maintien dans l’emploi et droits renforcés pour les proches aidants.
La lutte contre le cancer ne peut uniquement reposer sur les individus, elle exige une mobilisation collective pour une société plus protectrice. À l’occasion de cette journée mondiale, l’UNSA réaffirme son engagement à exprimer ces exigences auprès des pouvoirs publics, des employeurs et de l’ensemble des acteurs de la santé.
Crédit image : rawpixel.com on Freepik [...]
Lire la suite…
Emploi des jeunes : l’UNSA dit non au CPE 2.04 février 2026Sous couvert de lutte contre le chômage des jeunes, le Medef propose la création d’un CDI pouvant être rompu sans motif pendant les premières années, assorti d’une remise en cause du SMIC et des protections existantes. Pour l’UNSA, ces propositions ne répondent en rien aux difficultés d’insertion des jeunes et organisent au contraire leur précarisation en en faisant des sous-travailleur·ses
Un CDI sans garanties : une fausse solution
Le Medef a récemment avancé l’idée d’un CDI « à droits progressifs », qui pourrait être rompu sans motif pendant les premières années. Officiellement, il s’agirait de « lever la peur de l’embauche » pour les jeunes peu ou pas qualifié·es. En réalité, cette proposition rappelle fortement le Contrat première embauche (CPE), massivement rejeté en 2006 par la jeunesse et retiré avant même son application.
Cette mesure s’inscrit dans une logique bien connue : sécuriser les employeur·euses en fragilisant les salarié·es, en particulier les plus jeunes qui devraient accepter l’instabilité comme prix d’entrée sur le marché du travail.
Une offensive globale contre les droits des jeunes
Le MEDEF ne s’arrête pas là. Il propose de moduler le SMIC pour certain·es jeunes, d’étendre le recours aux CDD, de supprimer les délais de carence entre contrats ou encore de faciliter le temps partiel. Présentées comme des outils d’« adéquation entre compétences et rémunération », ces mesures conduiraient surtout à une jeunesse moins payée, moins protégée et plus précaire.
La réalité du terrain ignorée
Ces propositions font l’impasse sur la réalité vécue par les jeunes : seuls 43 % des moins de 25 ans occupent un poste stable en CDI ou dans la fonction publique, contre 75 % en 1982. Le recours aux contrats précaires – CDD, intérim, alternance – s’est généralisé et le rendement des diplômes s’est érodé. Un diplômé de bac +2 a aujourd’hui 34 % de chances en moins qu’en 1983 d’occuper un emploi correspondant à sa qualification. Cette situation nourrit un sentiment de déclassement : 15 % des jeunes estiment que leurs compétences dépassent ce qui est attendu sur leur poste [1]..
L’insertion professionnelle des jeunes reste par ailleurs inégale : le chômage des 15-24 ans atteint 18,8% au 3e trimestre 2025, supérieur à la moyenne européenne (14,5 %), et plus de 12,5 % sont en situation de NEET (ni en emploi, ni en étude, ni en travail) [2] .
Les jeunes sont ainsi exposés à une double vulnérabilité : une précarité contractuelle et une difficulté à stabiliser leur trajectoire professionnelle.
L’UNSA s’oppose donc fermement aux propositions du Medef. La lutte contre le chômage des jeunes ne passera ni par la remise en cause du CDI, ni par la baisse des salaires, ni non plus par l’affaiblissement du droit du travail. Elle exige au contraire des emplois durables, une véritable politique de formation et une sécurisation des parcours professionnels.
Faire de la précarité la norme n’a jamais créé d’emplois de qualité. L’UNSA continuera de défendre une insertion professionnelle fondée sur la dignité, les droits et l’avenir des jeunes.
Crédit image : Drazen Zigic on Freepik
Notes
[1] Haut Commissariat à la Stratégie et au Plan, Jeunesse d’hier et d’aujourd’hui : le grand déclassement ?, octobre 2025
[2] Insee, 2025. [...]
Lire la suite…
















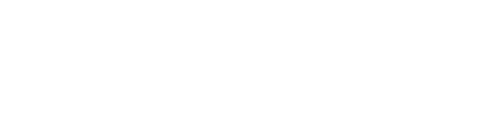

 03 22 72 52 22
03 22 72 52 22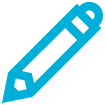 ud-80@unsa.org
ud-80@unsa.org